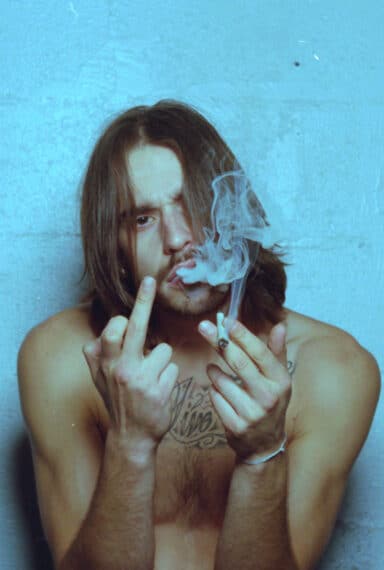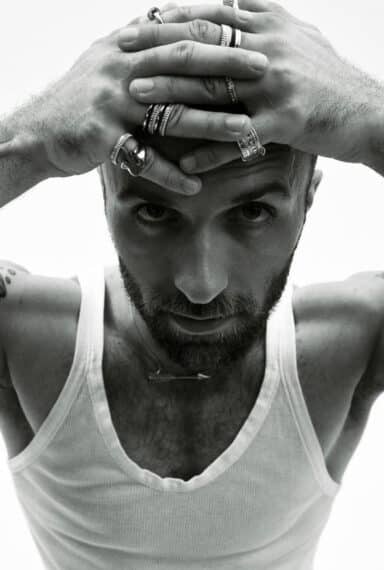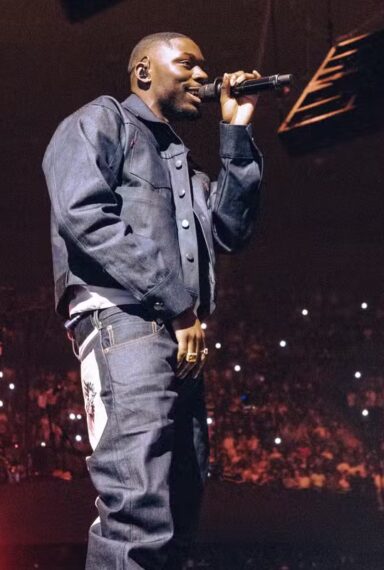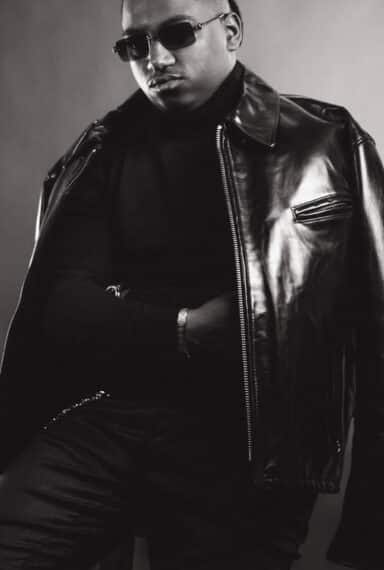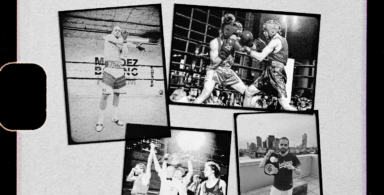Les quadragénaires sont de plus en plus nombreux dans le sport de haut niveau. Il y a une dizaine d’années, peu importe la discipline, il était rare de poursuivre sa carrière sportive au-delà de la trentaine (exemple : Zinédine Zidane a dit stop à 34 ans en 2006). Une tendance désormais révolue. La retraite est constamment reportée, comme si l’éternel pouvait être approché. Pourquoi les sportifs professionnels durent-ils plus longtemps qu’auparavant ?
Personne ne peut passer à côté du phénomène. Que ce soit dans le football avec Cristiano Ronaldo (40 ans) et Lionel Messi (38 ans en juin), dans le basketball avec LeBron James (40 ans), dans le tennis avec Novak Djokovic (38 ans en mai) ou encore en Formule 1 avec Fernando Alonso (43 ans) et Lewis Hamilton (40 ans), il est impossible de rater les prouesses de ces « vétérans » au crépuscule de leur carrière. Ils sont toujours au top de leur forme et tiennent tête aux talents émergents.

Si la génétique n’y est pas pour rien, cette génération dorée semble n’avoir aucune limite pour faire face à l’épreuve du temps. Pour eux, l’âge n’est qu’un chiffre. Seule la manière dont ils nourrissent leur esprit et leurs corps a de l’importance. « Paradoxalement, il est possible de progresser jusqu’à tard dans des sports d’endurance. Les fibres lentes ne diminuent pas avec l’âge, au contraire des fibres rouges qui sont reliées à l’explosivité. Il est donc difficile, 35 ans passés, d’être performant dans des sports utilisant ces fibres (basketball, football etc.). LeBron James est un contre-exemple idéal et un sportif d’exception. Il en existe peu comme lui » révèle Marc Giaoui, médecin traumatologue du sport au sein de la Clinique du sport dans le Ve arrondissement de Paris et ancien volleyeur professionnel. Alors comment expliquer ces folles longévités ?
Il est difficile, 35 ans passés, d’être performant dans des sports utilisant des fibres rouges (basketball, football etc.). LeBron James est un contre-exemple idéal.
Marc Giaoui, médecin traumatologue du sport

Évolution des mentalités et de la science : un cocktail efficace
Depuis la fin du 20e siècle, le sport mondial s’est professionnalisé. Les athlètes consacrent désormais 100% de leur temps à leur activité. Auparavant, certain(e)s étaient contraint(e)s de travailler à côté pour subvenir à leurs besoins primaires. En conséquence, ils devaient arrêter leur carrière au début de la trentaine à cause d’un corps abîmé par la vie. « Il n’y avait pas d’entretien et de règles hygiéno-diététiques comme aujourd’hui », précise Marc Giaoui.
Depuis quelques années, de nombreux athlètes se distinguent par une hygiène de vie irréprochable. Les plus grand(e)s champion(nes) ne laissent rien au hasard, que ce soit dans l’alimentation, la préparation physique ou encore l’entretien de leur outil de travail. Les sacrifices se transforment en banalité du quotidien. « Les sportifs modernes font beaucoup plus attention à leur performance. Ils sont davantage individualistes et voient leur carrière de manière plus centrée. Le plus gros changement provient de l’athlète en personne. C’est lui qui a décidé à un moment donné de faire le nécessaire pour durer plus longtemps. J’entends par là, l’alimentation, le sommeil, le mental et une bonne gestion des sorties », explique Sidney Govou, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et consultant pour Canal +.
Il y a également eu une amélioration notable de la prise en charge médicale et paramédicale. Les diagnostics se veulent plus précis que par le passé. Les « vétérans » encore actifs sont celles et ceux qui tirent le plus de bénéfices de l’évolution de la médecine. « Il y a plus de travaux individuels et de kinés dans les clubs. Jusqu’à ma retraite sportive, j’ai accentué les soins et les temps de récupération. Je prenais aussi des compléments alimentaires. Il faut être prêt à faire des sacrifices sur la durée. La passion doit être au centre de tout », détaille Benjamin Nivet, consultant et ancien footballeur de l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC). Le natif de Chartres a marqué l’histoire des championnats de France (Ligue 1 et Ligue 2) en foulant les terrains verts jusqu’à ses 42 ans avec le club de sa vie, Troyes.
Les sportifs modernes font beaucoup plus attention à leur performance. Ils sont davantage individualistes et voient leur carrière de manière plus centrée.
Sidney Govou, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et consultant pour Canal +.

À cela s’ajoute la perpétuelle création de nouvelles méthodes de récupération. Il existe les bains chauds et froids, les bottes de compression (améliore la circulation sanguine et au drainage lymphatique), la cryothérapie (soulage les douleurs et réduit l’inflammation) ou encore le suivi individualisé par un kinésithérapeute. Des méthodes « game changer » tant les physiques des sportifs sont mis à rude épreuve. « Quand j’étais encore actif, on n’était qu’au début du développement des méthodes de récupération. Par exemple, on faisait des bains froids, mais dans des poubelles à Lyon », raconte Sidney Govou.

Selon l’ancien numéro 14 de l’Olympique Lyonnais, ces différents procédés efficaces pour favoriser la récupération sont avant tout des effets de mode. « Les méthodes de récupération changent tous les 5-6 ans. Cela me fait marrer. Les études sont réalisées par des mecs qui valorisent leur propre produit », nuance-t-il. Même son de cloche pour Marc Giaoui. « Il faut se méfier des tendances pour la récupération. Elle doit être adaptée à chacun. Il n’y a pas de généralité. Les phénomènes de mode trompent parfois le grand public. »
Les sportifs disposent aussi de coach mental pour gérer le stress et mieux appréhender les grandes échéances à venir. L’accompagnement mental s’est considérablement amélioré dans le temps. « Le mental est fondamental pour durer. Si tu es bien dans ta tête, tu vas être bon sur le terrain et éviter les blessures. Pour continuer à être performant à 40 ans, il faut avoir de la résilience et surtout un équilibre entre le mental et le physique », confie Benjamin Nivet.
Pour continuer à être performant à 40 ans, il faut avoir de la résilience et surtout un équilibre entre le mental et le physique.
Benjamin Nivet, consultant et ancien footballeur de l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC).
Une meilleure prévention face aux blessures
Globalement, les sportifs professionnels actuels sont plus armés pour faire face aux blessures. En effet, ils disposent, pour les plus chanceux et chanceuses, d’un suivi personnalisé à l’entraînement. Ainsi, ils utilisent des données précises pour optimiser une reprise. « Avec le suivi aux entraînements grâce aux GPS pour les données cardiaques par exemple, la prévention s’est améliorée. Après une blessure, les athlètes reprennent beaucoup plus rapidement grâce à la réathlétisation. Ils gagnent du temps de récupération avec des techniques comme l’imagerie motrice. Par exemple, le sportif va s’imaginer pratiquer. Les connexions entre le cerveau et le muscle vont alors persister. La commande nerveuse va être entraînée sans la contraction musculaire. Ils sont accompagnés par des staffs entiers. Cela permet de tirer le meilleur de l’athlète sur la durée », développe Romuald Lepers, chercheur à l’Université de Bourgogne Franche-Comté et auteur du livre « Athlète Master, s’entraîner et performer après 40 ans, 50 ans et plus ».

Pour accompagner leur activité principale, les sportifs ajoutent, pour la plupart, des séances de renforcement à la salle de musculation. Cela fait partie intégrante de leur entraînement. Un changement net par rapport aux anciennes pratiques. « Au tennis, ils jouent de manière asymétrique donc il est nécessaire d’équilibrer les muscles à l’extérieur. Quant aux footballeurs, ils doivent travailler le quadriceps et la cuisse afin de réduire le risque de blessure », poursuit Romuald Lepers.
De son côté, Benjamin Nivet bénéficiait d’un entraînement adapté grâce à son club et à son entraîneur de l’époque, Jean-Louis Garcia. « À partir de mes 37 ans, j’ai commencé à perdre en vivacité et je mettais plus de temps à récupérer après les matchs. Aux alentours de la 75e minute de jeu, je puisais dans mes réserves. Jean-Louis Garcia savait me ménager. Par exemple, il m’arrivait de m’entraîner une fois de moins que mes coéquipiers dans la semaine. La relation avec le coach et l’accompagnement du club sont également des facteurs clé pour durer », complète-t-il.
Une quête perpétuelle aux records
Au-delà de prolonger le plaisir, plusieurs sportifs « vétérans » sont obsédés à l’idée de battre des records. Cette soif de reconnaissance et de gloire repousse les limites du corps humain. On peut notamment citer Cristiano Ronaldo et son envie d’atteindre les 1 000 buts en carrière (il est actuellement à 928 réalisations) ou encore Novak Djokovic avec sa quête du 25e Grand Chelem tant attendu. Durer plus longtemps, c’est aussi gagner plus d’argent, bien que les superstars ne soient plus dans le besoin. « La façon la plus “simple” de marquer l’histoire de son sport, c’est d’avoir une folle longévité. Cette façon de penser est très présente chez les joueurs actuels. C’était moins le cas à mon époque. J’ai l’impression que durer longtemps et plus important que d’être performant », regrette Sidney Govou.

Vous l’aurez compris, dans un futur proche, les « vieux briscards » risquent donc de se multiplier dans les différentes disciplines. Les légendes nées à la fin des années 80 ne devraient plus être seules bien longtemps.